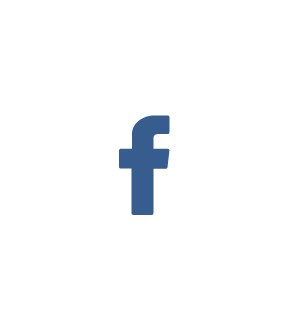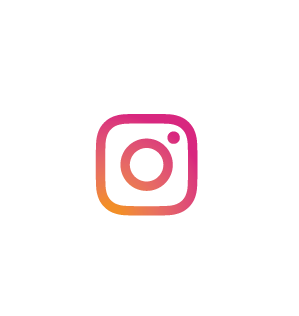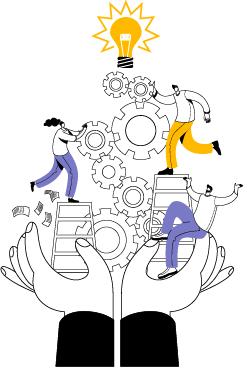Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les grandes vitres bleues illuminant la chambre d’une lumière bleuâtre. Le toit descendait en pente raide avant de s’arrêter abruptement plusieurs pieds au-dessus du sol pavé de briques pâles et déchiquetés par les nombreuses voitures qui s’étaient autrefois hasardées par cette ruelle. La peinture brunâtre de la maison se transformait en gris poussiéreux, donnant à la maison un air vieux et mal entretenu.
Je me réveille d’un coup, ma main agrippant mon t-shirt préféré. Une odeur âcre de fumée me donne la nausée alors que je me redresse sur mon matelas crasseux pour prendre de l’air frais. Mon frère est endormi sur son lit en face qui est tout aussi abimé que le mien. Je me lève pour le réveiller avant de me rendre compte que son torse est immobile. Je me dépêche d’aller le secouer, pour le voir se réveiller comme tous les matins. Seulement aujourd’hui, ses yeux ne s’ouvrent pas. Je sens de l’acide me remonter dans la gorge et mes yeux picoter. Des larmes commencent à couler sur mes joues humides et dégoulinantes de sueur. Mon cœur se serre quand je regarde son petit corps sur le matelas. Il n’avait que sept ans. Ce n’était pas à lui de mourir. Pas maintenant. Lui répétant de ne pas me laisser. La colère m’envahit. Pourquoi Maman était-elle partie ? Pourquoi m’a-t-elle laissée seul avec lui ? C’était de sa faute.
En partant, elle avait emmené avec elle une portion de la nourriture. Deux semaines plus tard, on avait tout mangé. Depuis lors nous n’avions pas eu grand-chose à nous mettre dans l’estomac. Après que les adultes du quartier avaient finit de discuter de la guerre sur la grande place, nous trouvions quelquefois quelques chips ou des trognons de pain par terre sous leurs chaises ou sous les tables verdâtres. Maintenant, ils étaient tous partis de cette maudite rue et nous n’avions plus rien à manger depuis. Et le résultat ? Mon petit frère est mort. De sa faute. Après la mort de papa dans le bombardement du quartier, elle avait commencé à déprimer. Elle ne nous parlait presque plus, sauf quand elle avait besoin qu’on fasse quelque chose. Elle ne dormait plus. Puis, un jour, elle est partie. Juste comme ça. Sans laisser de message, rien. Et maintenant, Sami était parti lui aussi.
Couvrant le corps de Sami d’une couverture moisie que nous utilisions pour nous garder au chaud la nuit, je claque la porte derrière moi et sors de la maison sans me retourner. En marchant vers la grande place je remarque que l’épicerie est ouverte et que ça sent le baklava à plein nez. Comme par instinct, je me dirige tout de suite vers la porte. L’épicier n’avait pas ouvert depuis que les bombardements avaient commencés. Sami et moi ne n’ouvrions quasiment jamais notre porte non plus. Les pilleurs du quartier ramenaient quelques fois des armes et nous ne voulions pas leurs faire croire que quelqu’un habitait dans notre maison, ni que nous avions de la nourriture.
Je rentre dans le magasin, l’odeur s’intensifie, me donnant l’eau à la bouche. Me voyant rentrer, l’épicier sursaute. Mais, me reconnaissant, ses épaules retombent et il m’offre un sourire accueillant. Allongeant la pâte dans le plateau de cuisson, il me demande : « Alors comment va ton frère, Remi ? » Je repense au corps de Sami allongé immobile et les larmes me remontent aux yeux mais je réussis quand même à lui avouer : « Il, il est mort. » Je ravale mes larmes, baissant les yeux pour ne pas le voir s’apitoyer sur mon sort. « Oh, je suis désolé Remi. » dit-il tristement. Essayant de changer de sujet, je lui demande : « Vous allez rouvrir l’épicerie ? » Il sourit comme si je lui avais donné un compliment, il me répond : « Oui ! J’ai profité de la fermeture pour renforcer la sécurité du magasin pour éviter que les pilleurs ne volent tout. » Il jette furtivement un coup d’œil dans la ruelle. « Mais ça ne va pas me faire éviter les gendarmes. »
Je secoue la tête en repensant aux maintes fois que les gendarmes étaient venus dans le quartier pour semer la terreur. Mais en partant, je ne devrais plus subir tout cela. Voici pourquoi je devais m’en aller bientôt. L’épicier me tend une tranche de baklava bien tiède, fraichement sortie du four, avec une croute légère et croustillante. Je l’avale tout rond avant de marmonner la bouche pleine : « Merci, c’est trop bon ! » en soupirant de satisfaction. Il rigole et me tend une autre part en me disant : « Tiens, c’est sur la maison. » Je lui fais un sourire reconnaissant avant de lui avouer que je m’en allais. Il me prend dans ses bras et s’exclame : « Allez file ! Bon voyage ! » Je me retourne une dernière fois pour lui sourire avant de m’avancer dans la rue opposée à l’épicerie.

Une heure plus tard je n’ai vu personne, ni gendarmes, ni pilleurs. Une ou deux fois j’ai rencontré un chien ou un chat errant qui m’a suivi en reniflant le petit bout de baklava que j’avais gardé pour le voyage. Au bout de trois heures de marche, une faim atroce me ronge l’estomac. Je mange trois chips que j’avais trouvé dans un bol sur le carrelage d’une échoppe pillée et je continue mon chemin. Soudain, j’entends des coups de feu dans la rue. Je me dépêche de me cacher derrière une bannière moisie montée derrière un petit muret en pierre et attend. Des bruits de pas s’approchent et je me pousse de plus en plus contre le mur.
Mon pouls s’accélère quand j’entends les voix des gendarmes qui s’approchent. Je jette un coup d’œil très rapide aux gendarmes et je me rends compte qu’ils s’en vont. Ils avaient surement entendu une voiture ou des gens vivant aux alentours. Mon cœur se remet à battre à un rythme normal et je me rends compte que je suis très fatigué par mon voyage. Je me retourne, aplatis la bannière sous ma tête pour m’en servir comme un oreiller et je m’endors sur le coup. Que va-t-il se passer demain ?